Extrait 2 du livre "Itinéraire Mouvementé"
- Valérie GALENO-DELOGU, fondatrice EMVC
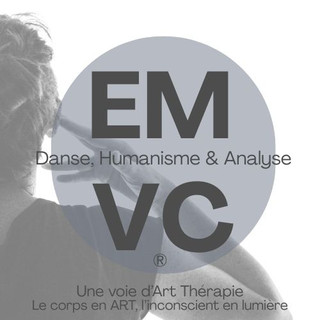
- il y a 2 jours
- 3 min de lecture
Dernière mise à jour : il y a 24 heures
« À quatre ans, la danse classique est une première aurore : le corps s’éveille au mystère du mouvement, rencontre la musique comme une complice et découvre, dans le battement des pas et la droiture de la barre, l’ébauche d’un langage qui le portera bien au-delà de lui-même. » Valérie GALENO-DELOGU
À 4 ans, un jour de pluie, je fais une rencontre marquante. Une grande dame, vêtue de noir, avec une allure noble qui se prolonge jusqu’au bout de ses pieds fins et gracieux. Longiligne et élégante, elle esquisse des pas de danse classique sous mon regard émerveillé. Fascinée, je m’essaie à la barre pour la première fois. Mais mes premiers pas sont maladroits, remplis de confusion. Je me sens maladroite, incapable de distinguer ma droite de ma gauche. Mauvaise latéralisation ? Peut-être. Ce n’est pas la fin du monde, mais cette difficulté soulève des questions : Est-ce de la distraction ? Un environnement complexe ou stressant ? Une possible dyslexie ou un trouble de l’apprentissage ? Avec le recul, je comprends que je souffrais d’une carence affective. Mon désir de bien faire était une quête silencieuse de reconnaissance. Les liens d’attachement étaient fragiles, et la figure d’attachement qui aurait dû me procurer une base de sécurité interne vacillait. Il y a bien des années, dans le monde de mon enfance, danser « bien » n’était pas seulement un plaisir. C’était un enjeu. Chaque pas maîtrisé, chaque mouvement correctement exécuté pouvait rapporter un bon point. Dix bons points, et l’on gagnait une image : une petite carte cartonnée, illustrée de scènes colorées, qu’on serrait comme un trésor dans ses mains d’enfant. Une gloire de papier, fragile mais si précieuse.
Je me souviens de cette sensation : l’envie d’être choisie, reconnue, applaudie. Comme si le droit d’exister aux yeux des autres dépendait d’une série de petits gestes « parfaits ». C’était troublant, au fond : on nous apprenait très tôt que l’amour, l’attention, se méritaient. Que l’expression de soi, même à travers la danse, devait être « bien faite » pour être validée. Et moi, au milieu de tout ça, je faisais tout pour plaire. Je m’appliquais, je comptais mes pas, je souriais au bon moment. Bien avant d’apprendre ce que signifiait danser pour moi-même.
Les bons points, à l’époque, étaient partout. Certains enfants en accumulaient des piles, comme des trophées ; d’autres peinaient à en décrocher un seul. C’était censé nous motiver, nous tirer vers le haut. Mais je revois encore ceux qui baissaient les yeux, les poches vides, tandis que d’autres brandissaient leurs images comme des médailles. Il y avait une compétition silencieuse, une hiérarchie implicite, et je me souviens avoir compris, très jeune, que la valeur d’un enfant pouvait se mesurer à ce qu’il avait entre les mains.
Moi, je voulais juste qu’on me voie. Et pour cela, je dansais…
Dans les années de mon enfance, discipline et rigueur faisaient partie intégrante du processus d’apprentissage, que ce soit en danse ou dans tout autre art. Elles n’étaient pas perçues comme des contraintes arbitraires, mais comme des fondations indispensables à l’exploration et à la maîtrise d’une pratique. La rigueur n’était pas synonyme de rigidité, mais plutôt d’une forme d’engagement profond, d’un dialogue exigeant entre le corps, l’esprit et l’art. Il ne s’agissait pas seulement de répéter mécaniquement des gestes ou des techniques, mais de cultiver une forme de présence, d’attention minutieuse au détail, une recherche patiente et persévérante. Cette discipline forgeait non seulement le corps, mais aussi la pensée et la sensibilité, permettant d’accéder, au-delà de la technique, à une forme de liberté plus authentique et maîtrisée.
Aujourd’hui, une approche plus intuitive et décomplexée a pris place dans l’enseignement artistique, avec le souci de préserver la spontanéité et le plaisir. Si cette évolution a permis d’ouvrir les pratiques à un plus large public, elle a parfois occulté la valeur du labeur, du dépassement de soi et de la structuration qu’offre une discipline approfondie. Or, c’est souvent dans la tension entre contrainte et expression que l’art naît véritablement, car la contrainte bien intégrée devient un tremplin vers la création, et non un carcan qui l’étouffe.










Commentaires